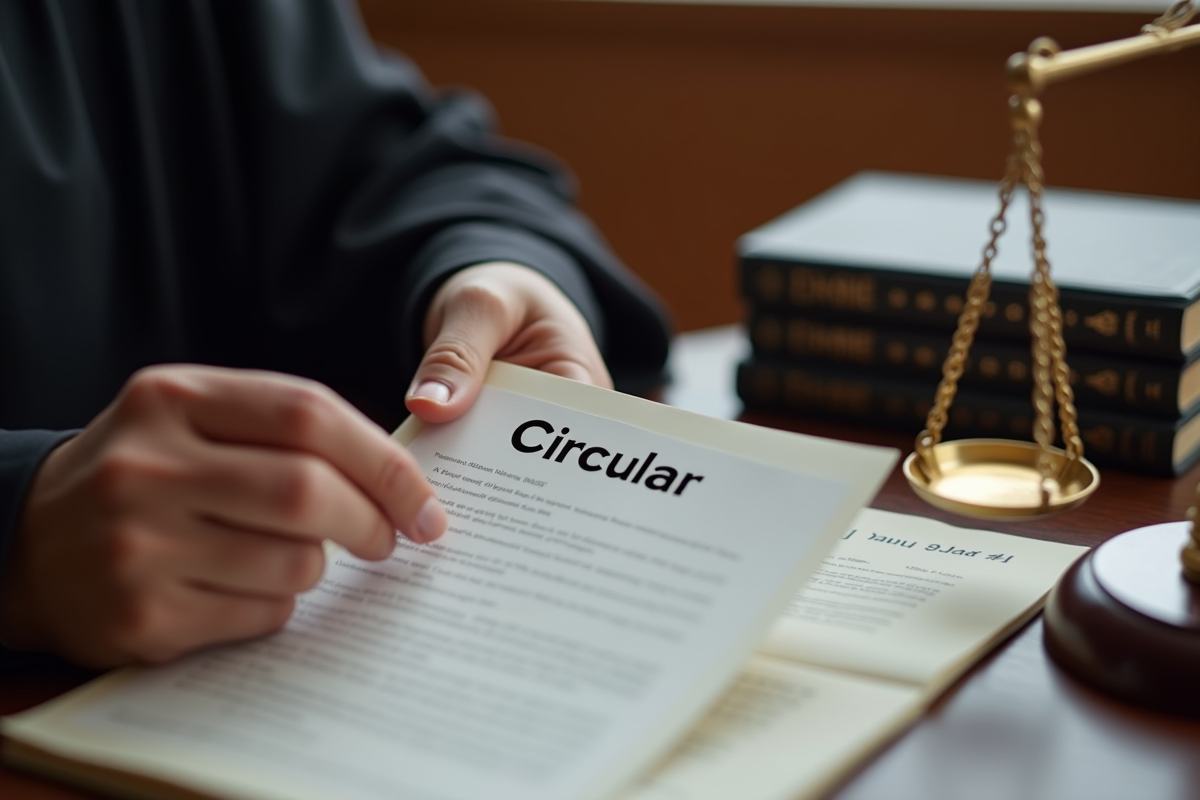Un chiffre sec, froid, peut transformer la vie d’un immeuble : il suffit qu’un copropriétaire refuse de voter sur une résolution pour que sa voix s’évapore du calcul des majorités. Sauf si l’article 25 du code de la copropriété s’invite dans l’équation. Autre cas de figure : un lot détenu par une société n’obéit pas tout à fait aux mêmes règles, et le collectif s’en trouve parfois bousculé.
Des blocages surgissent alors, alimentés par une poignée de copropriétaires qui, sans jamais réunir la majorité, empêchent le passage de mesures parfois urgentes. Les évolutions législatives récentes ont rebattu les cartes, modifiant la manière dont les immeubles s’organisent et prennent leurs décisions.
Ce que change l’article 25 dans la prise de décision en copropriété
L’article 25 rebat sérieusement les règles du jeu en assemblée générale. Désormais, la majorité absolue ne concerne plus seulement les voix présentes ou représentées. Ce sont toutes les voix de chaque copropriétaire qui entrent dans le décompte, qu’ils soient là ou non. Cette généralisation transforme radicalement les rapports de force et la capacité de faire passer les décisions majeures.
Le conseil syndical doit donc s’ajuster à ce nouveau seuil : valider une résolution nécessite d’obtenir la moitié des voix, plus une, sur la totalité des voix constituant le syndicat. Dès qu’il s’agit d’aménager la répartition des charges, de modifier les parties communes ou d’actualiser le règlement, le passage par cette majorité est incontournable.
Pour illustrer concrètement l’effet de ce mécanisme, voici ce que cette règle change au quotidien dans une copropriété :
- Impact sur la gouvernance : il est désormais indispensable de fédérer bien au-delà du cercle habituel des votants, sous peine de blocage.
- Droit de vote : chaque voix conserve un poids réel, même sans grande participation en assemblée, forçant chacun à s’impliquer davantage.
La loi a toutefois prévu une échappatoire. Si cette majorité absolue n’est pas atteinte du premier coup, une seconde délibération peut se tenir. Cette fois, la majorité simple des présents et représentés suffit. Mais sans mobilisation effective des copropriétaires, l’effet du rattrapage reste très limité. Face à ces obstacles, le syndic doit souvent batailler pour appliquer ce que la collectivité souhaite.
Comment s’applique la majorité absolue lors des assemblées générales ?
L’application de la majorité absolue en assemblée générale requiert méthode et organisation. Pour toutes les décisions soumises à l’article 25, il faut réunir la majorité des voix de tous les copropriétaires, indépendamment de leur présence. Cela suppose d’anticiper en amont comment mobiliser et représenter les voix.
Ce mode de vote s’impose sur un éventail de décisions : désignation ou révocation d’un syndic, choix des membres du conseil syndical, travaux sur les parties communes ou adaptation du règlement de copropriété. Pour participer, chaque copropriétaire peut voter en direct, donner une procuration ou faire usage du vote par correspondance, désormais mieux cadré à travers le procès-verbal.
Pour mieux cerner comment fonctionne ce vote, voici les enseignements à retenir :
- La majorité absolue implique de compter les voix favorables sur l’ensemble des voix de la copropriété.
- Les absents et abstentionnistes ne disparaissent pas du calcul, ce qui rend le seuil plus difficile à franchir.
- L’usage des procurations peut s’avérer décisif pour franchir la barre requise.
Ce dispositif n’est pas qu’une formalité ; il oblige à engager des discussions en amont et à bâtir de véritables stratégies collectives. Si la majorité ne se dégage toujours pas, l’article 25-1 prévoit que la question soit soumise une nouvelle fois à la majorité simple, à condition que la moitié des voix ait été engagée lors du premier vote.
Ressources et conseils pour naviguer les évolutions légales récentes
L’évolution de la législation, sous l’action notamment de la loi ALUR puis de la loi ELAN, a rendu le cadre réglementaire plus dense. L’apparition de la passerelle de majorité de l’article 25-1 a apporté sa part de complexité supplémentaire sur le terrain. Syndics et conseils syndicaux sont amenés à redoubler de vigilance, qu’il s’agisse de revoir le règlement de copropriété ou de lancer des travaux d’économie d’énergie. Parfois, face au flou de certaines situations, la jurisprudence vient trancher et les procédures contentieuses se multiplient.
Adapter les documents et les pratiques collectives ne consiste plus seulement à gérer l’ordinaire : il faut désormais prévoir les futurs conflits, veiller à la proportionnalité des décisions, et garantir que la fameuse passerelle de l’article 25-1 s’appliquera convenablement. Pour y voir plus clair dans ce maquis, plusieurs leviers peuvent aujourd’hui faire la différence :
- Étudier les derniers arrêts rendus par la jurisprudence sur la majorité en copropriété.
- Encourager la formation, régulière, des membres du conseil syndical pour affiner leur compréhension des nouveaux textes.
- Actualiser régulièrement sa veille sur les guides techniques distribués par les fédérations ou associations spécialisées, qui synthétisent les ajustements réglementaires.
Piloter efficacement une copropriété, c’est aujourd’hui composer avec le niveau d’exigence croissant : rechercher la majorité absolue, anticiper les recours judiciaires, s’assurer du respect strict des démarches pour chaque projet d’amélioration énergétique. Ceux qui sollicitent des spécialistes du droit sécurisent chaque étape, autant sur la mise à jour du règlement que lors des votes en assemblée. À l’heure où une seule voix peut faire basculer un projet, la gestion collective prend des allures de discipline de précision.